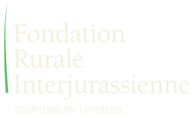La qualité du sol : clé de voûte pour supporter les aléas climatiques !
Face aux aléas climatiques et aux « trop » associés, il est essentiel que le sol soit le plus fonctionnel possible afin que la réserve utile en eau soit au maximum de sa capacité pour la saison où le stress hydrique est à son comble et que les excès d’eau soient évacués au plus vite lors de précipitations abondantes. Trois paramètres jouent un rôle primordial dans ce rôle de stockage-restitution-évacuation de l’eau : la granulométrie (c’est-à-dire la proportion d’argile-limon-sable), la porosité et sa connectivité, finalement la quantité et la qualité de la matière organique du sol.
La granulométrie
Il est évidemment impossible de jouer sur la granulométrie d’un sol. Nous héritons d’un patrimoine et nous devons le valoriser au maximum. A ce stade de compréhension, ce qui est intéressant de relever, c’est que dans un sol humide, il sera plus simple pour une racine de s’alimenter, s’il contient beaucoup de sable plutôt que de l’argile. Autrement dit, un sol argileux retient très bien l’eau, mais cette dernière est peu accessible aux plantes.

La structure grumeleuse assure une fertilité optimale
La porosité
En ce qui concerne la porosité et sa connectivité, pour faire schématique, il y a trois grands types de « tubes » :
- Ceux qui sont grossiers et larges qui permettent d’évacuer rapidement l’eau. Ce sont les galeries de vers de terre ou encore les interfaces entre les mottes. L’eau qui y circule n’est pas utilisable à long terme par les plantes mais cette porosité est essentielle pour évacuer le surplus d’eau afin que les racines soient oxygénées. C’est elle qui permet également d’éviter les flaques en surface.
- A son opposé, il y a la porosité fine. L’eau y est tellement intime avec le sol que la force de succion est trop importante pour qu’elle soit disponible pour les plantes.
- Entre deux, la porosité médiane participe à la « réserve utile en eau ». Le stockage y est plus ou moins durable, mais sans que la racine doive mettre trop d’énergie pour la prélever. Cette porosité moyenne se trouve au sein même des agrégats, autrement dit, des mottes de terre.
Cependant la taille des « tubes » n’est qu’un paramètre. Encore faut-il qu’ils soient connectés ensemble, pour qu’ils puissent avoir des échanges et jouer pleinement leurs rôles. C’est là que le travail du sol estival peut avoir des effets non souhaités. En passant un outil, type déchaumeur, nous allons remobiliser temporairement de l’eau en cassant les mottes. En parallèle, nous allons supprimer le lien entre la partie foisonnée et le sol sous-jacent. Cela signifie que si les pluies n’arrivent pas, le sol travaillé va s’assécher de manière problématique, car l’eau du sous-sol ne pourra plus humecter la surface.
Le tassement joue également un rôle néfaste sur la porosité. Plus la porosité est grossière, plus elle sera impactée par le poids des machines. Cependant il est plus facile de récréer de la macroporosité que de la mésoporosité. Il est donc essentiel de garder la « tuyauterie » du sol la plus ouverte et diversifiée possible, ainsi que connectée. Pour l’anecdote, plus de cinq tonnes sur l’essieu d’une machine agricole tassent le sol de manière quasiment irréversible, à des profondeurs inférieures à quarante centimètres. Cela signifie que toute la profondeur en dessous de 40 cm peut devenir parfaitement inutilisable par les plantes.

Une motte fermée ne joue plus son rôle dans le sol. Heureusement l’activité biologique (ici le ver de terre) permet de réactiver à terme l’agrégat.
Les matières organiques
Finalement, les matières organiques jouent un véritable rôle d’éponge. Il est impossible de parler des matières organiques de manière simple sans y passer des heures. Cependant, il y a une relation facile à mesurer et scientifiquement validée : le rapport entre le taux de matière organique et le taux d’argile. Lors des analyses de sols dans le cadre des prestations écologiques requises, demandez une vraie analyse de la granulométrie et de la matière organique (pas une évaluation visuelle). Si le rapport cité précédemment se trouve en dessous de 12%, votre sol est en souffrance et ne fonctionne pas. Entre 12% et 17%, la vulnérabilité du sol est importante. Entre 17% et 24%, votre sol fonctionne plutôt bien. Au-delà de 24%, votre « patrimoine sol » vous offre son plein potentiel.
Ce qui est intéressant dans cette relation entre le taux de matière organique et le taux d’argile, c’est qu’elle reflète également la qualité de la structure, c’est-à-dire de la taille et l’organisation des mottes.
Plus le rapport « matière organique – argile » est élevé, plus les agrégats du sol sont fins et de bonne qualité, plus la porosité est bonne, plus la réserve en eau est durable et moins il faut de la mécanisation pour faire un bon lit de semences.
A travers le projet « Terres Vivantes », il a été calculé que chaque % de matière organique en plus dans le sol permet de stocker 7.5 mm d’eau en plus, qui sera utilisable pour les plantes.
L’agriculture de conservation
Il est essentiel que le sol puisse donner son plein potentiel pour faire face aux aléas climatiques. Pour se faire, il faut le nourrir et le soigner. L’agriculture dite de conservation apporte des pistes de mise en œuvre pour y parvenir :
- Perturber le sol le moins possible. Afin de limiter la minéralisation des matières organiques, préférer un travail sol superficiel et modérer les actions de retournements.
- Couverture végétale la plus pérenne possible tout au long de l’année. Le sol reste ainsi vivant et travaille toute l’année.
- Les engrais de ferme « grossiers » tels que le fumier ou le fumier composté nourrissent le sol à l’image de la litière dans les forêts. De manière trop simpliste, les lisiers ou digestats liquides sont des engrais et ils favorisent la croissance des plantes. A contrario, des fumiers ou fumiers compostés sont des amendements et profitent au sol.

Le semis en bandes fraisées est l’une des nombreuses techniques qui limite le travail du sol à l’échelle de la parcelle.
A retenir
En résumé, il est essentiel que nos sols agricoles aient un rapport entre le taux de matière organique et le taux d’argile de 17% au minimum. Il faut tant que possible éviter les machines trop lourdes. Il faut couvrir et nourrir le sol en matières organiques et ne pas trop perturber sa surface.
La charrue, c’est comme les antibiotiques, elle ne doit pas être automatique.
Luc Scherrer
Terres Vivantes

Groupe WhatsApp Terres Vivantes