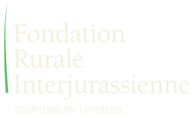Les vers de terre, véritables ingénieurs de l’écosystème (Les vers de terre – Ingénieurs de l’écosystème), jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement de ce dernier. Mais comment l’activité des vers de terre influence-t-elle le développement des racines, et par extension, la croissance des plantes ?
La fraction du sol influencée par les vers de terre (galeries, parois des galeries, déjections, etc.) est appelée la drilosphère. C’est dans ce milieu que l’on trouve des caractéristiques essentielles pour la croissance des plantes. Cet article se concentre principalement sur le rôle des déjections et des galeries dans le développement racinaire.
Les déjections des vers de terre, un mélange riche pour les plantes
Avez-vous déjà remarqué les petits monticules de terre à la surface du sol dans les cultures ou entre les brins d’herbe de la prairie ?
Se nourrissant majoritairement de matière végétale morte, les vers de terre rejettent un mélange riche, composé de matière organique et minérale. Les turricules ne représentent qu’environ 25% des déjections produites, le reste étant déposé dans les galeries.
Plusieurs estimations existent, selon M. B. Bouché, pour 1 tonne vif d’anécique, cela représente environ 270 tonnes/ha/an de matière sèche (MS). Les turricules en surface ne représenteraient qu’environ 67 tonnes/ha/an de MS.
Selon le FIBL, lorsque la nourriture est suffisamment abondante, la population de vers peut déposer entre 40 et 100 tonnes/ha/an de déjections. Cela représente donc 0,5 cm de sol dans les cultures et 1,5 cm dans les prairies par an !

Photos de turricules, déjections des vers de terre déposées à la surface du sol

Ce mélange, constitué de matière organique et minérale, est le lieu d’une grande activité microbienne. En effet, les vers, au travers de leurs déjections, déclenchent l’activité des micro-organismes. Ces derniers étant peu mobiles dans le sol, ils vont attendre le passage d’autres organismes (comme les vers) qui les mettront en présence de substrats organiques. Ce phénomène est appelé le « paradoxe de la Belle au bois dormant ».
Cette activité des micro-organismes va permettre de dégrader davantage les éléments organiques (les vers n’étant pas capables de digérer cette matière) et ainsi permettre aux vers de réingérer cette matière et de la digérer. Ainsi, une partie des déjections est réingérée après dégradation microbienne tandis que l’autre se transforme en agrégats organo-minéraux dans le sol.
Concernant les éléments nutritifs, on y trouve une plus grande concentration que dans le sol. En moyenne, par rapport à la terre environnante, on y trouve 5 fois plus d’azote, 7 fois plus de phosphore et 11 fois plus de potassium ! L’azote rejeté n’est globalement pas volatilisé car lié au carbone dans le mucus ou sous forme ammoniacale. Cet azote est ainsi directement assimilable par les plantes. Il n’est donc pas étonnant de voir des racines englober ce mélange, et donc les grumeaux formés, dans le sol.
Les galeries, tunnels de vie
Les galeries creusées par les vers de terre sont de plusieurs types selon la catégorie écologique de ces derniers (Les vers de terre – Ingénieurs de l’écosystème).

Photo de galeries de vers de terre

- Les anéciques creusent des galeries verticales et profondes. De cette manière, ils peuvent s’alimenter en surface de matière organique et choisir les conditions de température et d’humidité du sol à leur convenance.
- Les endogés creusent des galeries principalement horizontales, dans une couche peu profonde du sol (10 à 30 cm).
- Enfin, les épigés ne peuvent creuser le sol massif. Ils se situent dans la litière et la structure grumeleuse des premiers centimètres du sol. Si les conditions de température et d’humidité ne sont plus favorables, ils se réfugient dans les galeries profondes des anéciques.
En moyenne, on trouve 4 000 km de galeries à l’hectare. En surface, cela représente environ 5m2 de galeries pour 1 m2 de sol superficiel. Les pores créés par ces animaux sont interconnectés et participent à une bonne structure du sol. Cela permet également une meilleure infiltration de l’eau ainsi qu’une meilleure circulation de l’air.
Les racines peuvent coloniser ces galeries pour leur croissance. En moyenne, 90% des galeries des vers de terre sont occupées par des racines. Comme mentionné précédemment, les déjections des vers sont également rejetées dans le sol et les galeries en sont tapissés. Les racines ont ainsi accès à de l’eau, de l’air et des éléments nutritifs.
De nombreuses études ont mis en évidence l’effet positif des vers de terre sur la croissance des racines, leur densité et par conséquent, la croissance des plantes. Cependant, ces effets peuvent varier selon l’espèce de ver de terre, la plante concernée, le type de sol, etc. A ce jour, l’ensemble des mécanismes reste encore à comprendre et fait l’objet de diverses recherches.
Conclusion
En conclusion, les déjections des vers de terre, ainsi que leurs galeries, contribuent à une meilleure qualité du sol, ce qui favorise la croissance des racines et, par conséquent, la croissance des plantes. C’est un mélange riche en éléments nutritifs et stable, et les galeries des vers de terre apportent eau, oxygène et un passage pour la croissance des racines. Cette partie du sol, influencée par les vers de terre, peut être caractérisée comme la drilosphère.
Comme le formule M. B. Bouché : « Aux lombriciens le brassage des constituants minéraux et organiques, et le moulage des grumeaux, aux micro-organismes leur stabilisation, aux racines le soin d’y puiser les éléments nutritifs ».
Bibliographie :
Bertrand M. et al. (2015). Earthworm services for cropping systems. A review. Agron. Sustain. Dev., DOI: 10.1007/s13593-014-0269-7.
Bouché M. B. (2014). Des vers de terre et des hommes : découvrir nos écosystèmes fonctionnant à l’énergie solaire. Actes Sud, 321 pages. ISBN 978-2-330-02889-3.
Brown GG, Edwards CA, Brussaard L (2004) How earthworms affect plant growth: burrowing into the mechanisms. In: Edwards CA (ed) Earthworm ecology. CRC Press, Boca Raton, pp 13–49.
Lavelle P., C. Lattaud, D. Trigo, I. Barois. Mutualism and biodiversity in soils. In: The significance and regulation of soil biodiversity. p23-33. Springer, Dordrecht. 1995
Pfiffner L. et al. (2023). Vers de terre – architectes des sols fertiles : importance de ces organismes utiles et recommandations pour leur promotion dans l’agriculture. Fiche technique n°1619. Institut de recherche de l’agriculture biologique FIBL. DOI : 10.5281/zenodo.7708284.
Whalley W.R. & Dexter A.R. (1994) Root development and earthworm movement in relation to soil strength and structure, Archives of Agronomy and Soil Science, 38:1, 1-40, DOI: 10.1080/03650349409365834.
Terres Vivantes